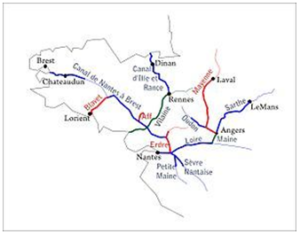Par Nicolas Saudray
Avouons-le : je suis un admirateur de Loti, malgré ses sucreries. Il a su, mieux que personne, rendre certaines ambiances, et fixer sur le papier des mondes aujourd’hui disparus.
Julien Viaud naît en janvier 1850 à Rochefort, chef d’œuvre préindustriel de la marine de Louis XIV. Sa famille paternelle est catholique, et la maternelle, protestante, comme beaucoup en cette contrée marquée par les guerres de religion. Obéissant momentanément à sa double hérédité, l’écrivain fera deux séjours à la Trappe de Bricquebec, et se mariera au temple avec une protestante. Mais il sera surtout attiré par l’islam, malgré son impossibilité de croire.
Le père est receveur municipal à Rochefort. En 1866, alors que Julien a seize ans, ce fonctionnaire est accusé de vol : un paquet de titres a disparu. Il passe quelques jours en prison. Finalement, il est innocenté, mais il a perdu sa place, et a dû se rabattre sur un petit emploi. De plus, il doit rembourser la valeur des titres, car c’est une des règles de la comptabilité publique, encore appliquée aujourd’hui – qu’il y ait eu faute ou non. La famille Viaud tombe de l’aisance dans la gêne.
Le fils de ce malheureux comptable public rêve d’aventure. Il ne se laisse pas décourager par le sort de son frère, mort en mer pour cause de dysenterie, après plusieurs années de service dans le Pacifique. En 1871, après sa sortie de l’Ecole Navale, Julien s’embarque pour un tour du monde. Il passe notamment à l’île de Pâques, où il est semble-t-il le premier à dessiner les fameuses statues. Ses croquis sont publiés par l’Illustration ; le dessinateur aura donc précédé l’écrivain. Suit un séjour de deux mois à Tahiti, au cours duquel les suivantes de la reine Pomaré lui donnent le surnom de Roti (laurier-rose), avec un r roulé. Roti ? Loti sonne mieux.
En 1874, l’enseigne de vaisseau vit une idylle à Saint-Louis du Sénégal. La belle finit par le rejeter. Humilié, furieux, Julien s’inscrit pour se changer les idées au bataillon de Joinville. Ce gringalet en ressort archi-musclé et, par plaisir, se produit comme acrobate dans un cirque de Toulon.
Viennent d’autres voyages, suscitant des publications. En 1883, l’enseigne de vaisseau Viaud participe à l’expédition du Tonkin. Il proteste dans le Figaro, sous la signature de Loti, contre un massacre auquel les troupes françaises se sont livrées à Hué. Aussitôt, on le rappelle à Paris. Va-t-il être révoqué ? Non, car le ministère s’est rendu compte, entre-temps, que les faits dénoncés par lui n’avaient rien d’imaginaire.
Cette affaire ne constitue pas une péripétie isolée dans la vie de l’officier-écrivain. Sans cesse, il va défendre les vieilles civilisations d’Asie contre l’avidité et la brutalité des Occidentaux. À sa manière, c’est un anti-colonialiste. On se tromperait lourdement en le fourrant dans le même sac que les écrivains nationalistes et traditionalistes de sa génération – les Barrès, les Bourget, les Bordeaux. Honneur à Loti !
Il se marie, sa femme lui donne un fils. Mais cinq ans après, il installe à Rochefort, non loin du domicile familial, une concubine basque espagnole qui le gratifie de deux autres fils.
A quarante et un ans, il est élu à l’Académie française, contre Zola. C’est alors le benjamin de cette assemblée.
En 1898, à quarante-huit ans, le voilà mis à la retraite d’office. Le ministère de la Marine veut rajeunir ses cadres – et il en a sans doute assez des foucades ou des mondanités de Loti. L’officier se pourvoit devant le Conseil d’État et obtient sa réintégration. Mais il est laissé quelque temps en congé sans solde.
En 1906, il est promu capitaine de vaisseau. Pas question de le nommer amiral. En 1910, le jour de son soixantième anniversaire, la retraite vient pour de bon. En 1914, à l’ouverture du conflit, Loti demande à revenir au service, mais la Marine ne veut plus de lui. Il se rattache donc à l’armée de Terre, et y accomplit diverses missions qui lui valent la Croix de Guerre. Il meurt en 1923. Obsèques nationales.
Les photos qui ont été recueillies montrent un petit homme affublé d’une moustache excessive. Il mettait des talonnettes. La courte taille a souvent été, dans l’histoire, la cause de grands désirs de revanche : le duc de Saint-Simon, Napoléon… Voici comment Edmond de Goncourt, qui a la dent dure, voit notre auteur en 1884, à trente-quatre ans : Un monsieur fluet, étriqué, maigriot, avec le gros nez sensuel de Carageuz, le polichinelle de l’Orient, et une petite voix qui a le mourant d’une voix de malade. Sitôt la jeunesse passée, Loti se maquille, soulignant son regard au crayon d’antimoine. Ce qui frappe surtout, dans l’album, c’est le goût de l’écrivain pour le travestissement. Il veut être un Turc, un Arabe, un Égyptien du temps des pharaons. Il rejette sa véritable identité.
xxx
À mon sens, les romans ne sont pas le meilleur de Loti : trop d’amourettes fades, trop de clinquant.
Je m’attacherai surtout à ce qu’on peut appeler le cycle d’Aziyadé. Le roman sans nom d’auteur qui porte ce titre (1879) est le premier de notre écrivain. Le narrateur, Loti, devenu pour brouiller les pistes un officier de marine britannique, fait d’abord escale à Salonique, encore turque. Il y remarque, à travers le grillage d’une fenêtre, une jeune et belle Circassienne aux yeux verts. Le navire de guerre poursuit sa route vers Constantinople. Coup de chance ! Aziyadé y vient aussi, avec le harem de son mari. Qui plus est, Loti parvient à la retrouver dans cette grande ville. Le vieux mari est retenu par ses affaires en Asie, et ses quatre épouses se sont promis de ne pas lui dénoncer leurs frasques respectives. En conséquence, durant des semaines, Aziyadé rejoint Loti presque toutes les nuits en une maison traditionnelle qu’il a louée. Peu vraisemblable, en ce pays où la femme musulmane est encore très surveillée.
Je gage que dans la réalité, il n’y a eu qu’un petit nombre de rencontres furtives. Ou encore qu’Aziyadé s’est carrément échappée de chez son époux, et n’y a plus remis les pieds tant que le Français pouvait l’héberger. On m’objectera que le roman suit de près le journal intime. Mais celui-ci est beaucoup trop travaillé, par endroits, pour qu’on puisse y voir une expression spontanée. C’est déjà une ébauche de roman.
Comme toujours chez Loti, cette aventure quelque peu vantarde est l’occasion de décrire des scènes pittoresques : une exécution de condamnés, une éclipse de lune…
Puis l’inévitable se produit : le bateau repart, Aziyadé est délaissée. Le narrateur montre alors son originalité. Il reçoit, en Angleterre, une lettre lui révélant que le vieux mari s’est douté de quelque chose, qu’il a mis sa jeune épouse en pénitence, qu’elle s’étiole…Trois mois après son départ, Loti revient à Constantinople ! Je me retrouvai appuyé contre une fontaine de marbre, près de la maison peinte de tulipes et de papillons jaunes qu’Aziyadé avait habitée. Malheureusement, elle n’est plus là. Une vieille femme révèle sa mort, et aide à retrouver sa tombe. Désespéré, Loti s’engage dans l’armée turque et se fait tuer par les Russes.
Deuxième livre du « cycle », moins connu, mais remarquable de mélancolie maîtrisée : Fantôme d’Orient (1892). Plutôt qu’un roman, c’est un récit, où presque tout sonne vrai. Loti relit Aziyadé, renie ses bravades, récrit le dénouement un peu forcé. Il a semble-t-il songé à faire évader Aziyadé, à l’amener en France ; entreprise trop hasardeuse. Le revoilà sur les lieux, non plus après trois mois, mais après dix ans. Le motif n’est pas seulement sentimental : Un charme dont je ne me déprendrai jamais m’a été jeté par l’islam. L’héroïne a survécu trois ans à son départ. Loti se met pour de bon à la recherche de sa tombe (car la première quête, dans le roman, n’était qu’une fantaisie littéraire, prémonitoire). Il cherche aussi celle de son jeune et fidèle serviteur Achmet, un Arménien devenu musulman, qui conserve dans son cœur une place presque égale à celle d’Aziyadé. Sa dernière nuit, lui révèle-t-on, tout le temps, il t’a appelé : Loti ! Loti ! Loti !
Le vétuste Stamboul reflète l’état d’âme du pèlerin : Je me dirige au trop dans ce dédale, reconnaissant au passage les quartiers sombres, les grands murs sans fenêtres, les vieux palais grillés (grillagés), les kiosques funéraires où des veilleuses brûlent, les grands dômes pâles des mosquées silencieuses, s’étageant dans le ciel… Et la lueur rougeâtre de notre lanterne qui court nous montre à terre, tout le long du chemin, des masses brunes qui sont les chiens endormis. Finies les fêtes. Seules restent la douleur et la culpabilité, comme une plaie qu’on gratte.
Pourquoi le fantôme du titre ? Chez Loti, c’est une image habituelle de la femme musulmane, enveloppée dans son voile noir. Bien que selon nos conceptions occidentales, un fantôme doive plutôt être blanc.
Troisième maillon de la chaîne, plus bref : Constantinople en 1890. Les Éditions Hachette ayant voulu présenter au grand public les principales capitales du monde, l’ottomane est comme de juste confiée à Loti. La Sainte Sagesse et le Vieux Sérail ont déjà été décrits, avec brio, par Théophile Gautier et par Edmondo de Amicis. Loti se dispense donc de descriptions. Il se contente des ambiances captées, et de sa réception par le sultan. Il déplore l’afflux des touristes. Que dirait-il aujourd’hui ! Malgré la brièveté de son séjour, il parvient à passer une partie de son temps dans les cimetières.
Quatrième maillon : le roman Les Désenchantées, fondé sur l’une des mystifications les plus réussies de l’histoire littéraire. En 1904, Marie-Amélie Hébrard, épouse Léra, journaliste féministe sous le nom de Marc Hélys, séjourne à Constantinople pour se documenter sur la vie des femmes musulmanes cloîtrées. Elle s’est fait, dans la haute société, deux amies turques, l’une mariée et l’autre pas encore. En avril 1904, apprenant que Loti, le célèbre écrivain, est de retour dans la ville, elle a l’idée de lui demander rendez-vous, sous de faux noms, pour elle-même et ses amies. Elle se présente comme étant Leyla, une Turque d’éducation française. Loti est appâté, il croit qu’il va revoir Aziyadé, en triple exemplaire. D’audacieux rendez-vous ont lieu, dans un petit café, dans une maison alliée… Mais les trois femmes se présentent toujours voilées, et ne laissent pas voir leur visage. L’une de leurs lettres est d’ailleurs signée Les Trois fantômes noirs. Loti étant tombé malade, elles viennent le voir à l’hôpital. Quand il revient sur son aviso le Vautour, elles lui rendent visite à bord. C’est un bâtiment désuet, à la proue en éperon, dont le seul rôle est d’affirmer la présence française en ces lieux, et qui ne quitte pratiquement jamais le Bosphore. L’écrivain-commandant joue du piano pour ses invitées.
Puis Amélie, poursuivant ses activités de journaliste, rentre à Paris. Elle a laissé aux deux sœurs constantinopolitaines des lettres écrites d’avance, afin qu’elles les postent une à une. Les rendez-vous se poursuivent, dont l’un au cimetière, car Loti a tenu à montrer la tombe de la petite Circassienne. Il finit par voir, fugitivement, le visage de ses deux interlocutrices. Il n’aura jamais vu celui de Leyla, et pour cause : en se découvrant, elle aurait jeté le doute sur son identité turque.
Mais le narrateur sait qu’il doit regagner la France. Une dernière fois, il revient sur les lieux de ses premières rencontres. Cette promenade le retint jusqu’à l’heure semi-obscure où les étoiles s’allument et où commencent de s’entendre les premiers aboiements des chiens errants. Au retour de ce pèlerinage, quand il se retrouva sous les énormes platanes de l’entrée, qui forment là une sorte de bocage sacré, il faisait déjà vraiment noir, et les pieds butaient contre les racines, allongées comme des serpents sous les amas de feuilles mortes. Dans l’obscurité, il revint au petit embarcadère, dont chaque pavé de granit lui était familier, et monta en caïque pour regagner la côte d’Europe. Le maître-écrivain donne ici sa mesure, avec peu de moyens, sans un mot de trop.
Fin mars 1905, comme dans toutes les aventures de Loti, le navire repart. Les deux sœurs pleurent. Pour elles, ce n’était plus une mystification. Elles s’étaient prises au jeu, elles s’étaient attachées à ce brillant homme de plume, qui d’ailleurs les aimait un peu, à sa manière à lui. La correspondance continue vaguement, entre Constantinople et Rochefort.
En décembre suivant, jugeant que la plaisanterie a assez duré, Amélie adresse à Loti, toujours sous le nom de Leyla, une lettre d’adieu qu’elle a pris soin de faire transiter par la capitale ottomane. Elle y expose que, sa famille ayant voulu la remarier de force, elle va mettre fin à ses jours, aussitôt après l’envoi de cette missive. On imagine le retentissement que ce message d’amour et de mort a eu chez l’écrivain.
Déjà, il a commencé son manuscrit des Désenchantées, en reproduisant d’assez près ce qu’il a vécu, et en y insérant les lettres des fantômes, presque sans modifications, sauf les noms ; Leyla est devenue Djénane.
Or voici que les deux sœurs, malheureuses en Turquie, s’échappent du harem et débarquent en France. Se sentant responsable, Loti les aide financièrement. L’une reste dans notre pays et s’y marie. L’autre retourne à Constantinople, où Loti la revoit en 1913.
Le roman Les Désenchantées a paru en juillet 1906. Vif succès. On est pourtant loin des hâbleries d’Aziyadé. Le narrateur ne prétend pas avoir couché avec ces jolies personnes, trop surveillées. Les seules libertés qu’il s’autorise consistent à dire qu’il a vu le visage de Leyla-Djénane, et à faire mourir l’une des deux sœurs – alors qu’elle est bien vivante, quelque part entre Dunkerque et Perpignan.
Peu après le décès de l’écrivain (1923), Amélie alias Marc Hélys publie un livre révélant le pot-aux-roses – avec les lettres authentiques des fantômes noirs, reproduites à peu près dans le roman. Elle se moque de l’écrivain tout en reconnaissant son génie. Rien n’a été exagéré, explique-t-elle, quant à la popularité de Pierre Loti parmi les femmes turques. Toutes en avaient la tête tournée.
À vrai dire, chacun a trouvé son compte dans cette embrouille. La féministe Amélie a suscité, pour le grand public, un livre qui illustre magistralement la sujétion de la femme ottomane. Les deux sœurs se sont libérées – ce qu’elles n’auraient jamais osé faire sans leurs rencontres avec Loti. L’écrivain a mis à son actif un roman un peu sinueux, un peu complaisant, mais évocateur et charmeur, où on aurait tort de voir une simple turquerie.
Cinquième et dernier élément du cycle d’Aziyadé : le journal intime des derniers séjours à Constantinople, publié en 1921 par Samuel Viaud pour le compte de son père hémiplégique. Avec son mauvais titre, Suprêmes visions d’0rient, l’ouvrage passe presque inaperçu. C’est pourtant une tranche de vérité, après les grâces et les artifices des romans.
Le bon fils s’est gardé d’évoquer le baptême de la chatte de Loti, célébré en grande pompe à bord du Vautour, sur le Bosphore, et qui a valu à son organisateur les sarcasmes d’un journal parisien (1903). Il passe également sous silence l’épisode de mars 1905, où la passion funéraire de Loti a atteint son sommet : l’ancien amant d’Aziyadé a fait copier la stèle de sa tombe, a mis la copie en place et est reparti sur son navire avec l’original. Ce qui aurait pu lui valoir, s’il s’était fait prendre, une condamnation en Turquie, suivie d’un blâme de son employeur. La stèle orne aujourd’hui une salle de la maison de Rochefort. C’est la preuve que la petite Circassienne a réellement existé, et qu’il s’agissait bien d’une femme.
Les Suprêmes visions débutent en 1910. Loti revient à Constantinople en jeune retraité. Il se fait héberger sur le détroit, dans le vieux palais de bois d’un ami franco-polonais, le comte Ostrorog. Lentement, sans bruit, les bateliers turcs ont fini par arriver, leurs avirons sur l’épaule. Mes malles sont dans les barques ; il faut se diriger vers les petites lumières de la rive d’en face. Et le glissement commence, au rythme des avirons, sur la grande nappe amie où notre passage laisse comme des plissures de soie. Il fait plus froid, et la buée habituelle des nuits du Bosphore augmente la pâleur des choses.
Puis Loti, presque seul de son espèce, s’installe dans le vieux Stamboul, parmi les hautes maisons de bois, déjetées par le temps et de couleur noirâtre… avec leurs observatoires comme des échauguettes, impénétrablement grillagés toujours, et d’où l’on croit sentir tomber des regards. Mais en période de ramadan, Stamboul s’anime et brille tous les soirs. L’écrivain cherche en vain la tombe de la fausse suicidée Djenane. Près d’une autre sépulture, réelle, celle d’Aziyadé, il cueille selon l’usage un bouquet de chardons bleus qu’il rapportera en souvenir.
Loti vitupère les Levantins – Grecs, Arméniens ou juifs – qui vivent surtout à Péra, sur l’autre rive de la Corne d’Or : un quartier très ancien mais modernisé. Il leur reproche de n’être pas musulmans, de croire au progrès, de singer l’Europe épileptique. Les Arméniens, passe encore ; il a dit du bien d’eux dans son livre sur Jérusalem. Sa détestation va surtout à la grécaille.
On peut placer en regard les Notes d’une voyageuse en Turquie de Marcelle Tinayre (1909). Cette romancière très connue à l’époque (La Maison du péché) s’intéresse, comme Marc Hélys peu avant elle, à la condition des musulmanes. Elle a lu Loti, bien sûr, et parfois elle fait du Loti. Le reste du temps, elle est précise, et n’hésite pas à aborder la politique intérieure turque ou la sociologie – ce dont notre écrivain s’était bien gardé. Les femmes turques, estime-t-elle, ne connaissent pas l’amour, sauf pour leurs enfants. Aussi les désenchantées étaient-elles fort rares parmi elles. Mais le livre de Loti en a fait éclore des douzaines.
La Constantinople de Loti peut aussi être comparée, une cinquantaine d’années plus tard, à l’lstanbul d’Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature. L’écrivain y a passé son enfance et sa jeunesse. Son récit, assorti de photographies dont celles du grand artiste Ara Güler, constitue le troisième volet de la décadence. Théophile Gautier avait décrit, en 1852, une métropole encore pimpante. Du temps de Loti, les menaces se précisent : décrépitude, perte de poids politique, invasion des horribles mœurs occidentales. Sous la plume de Pamuk, tout n’est plus que nostalgie, neige et brouillard ; la ville ne peut se consoler de la perte de son rang de capitale. Malgré sa solide culture française, l’auteur ne cite Loti qu’une fois ; sans doute lui en veut-il d’être le dernier à avoir pu mettre la ville en valeur.
On attend maintenant, sans trop d’espoir, le quatrième écrivain, celui qui saura faire aimer l’Istanbul oublieuse et surchargée d’aujourd’hui, avec sa population multipliée par douze depuis le temps de Loti, son désordre automobile remplaçant les milliers de caïques, et son Bosphore vassalisé par trois grands ponts.
Alors que Loti se trouve au sommet de sa gloire, la Turquie est attaquée successivement (1912-1913) par les États des Balkans, qui lui prennent Salonique, et par l’Italie, qui lui ravit à la fois Rhodes et la Libye. Le public européen soutient les Grecs. Seul ou presque avec son compère Claude Farrère, l’intrépide Loti se permet de défendre les Turcs. Et il a raison, malgré l’heure tardive. L’empire ottoman est une société plurielle, où des peuples de toutes sortes se mêlent depuis des siècles. Bien que miné par des nationalismes d’inspiration européenne, il conserve au début du XXe siècle une certaine cohérence. Sa destruction aura pour conséquence de mettre les peuples face à face, et provoquera des conflits sans fin (Arménie, Kurdistan, Liban, Syrie, Yémen…).
Loti est donc reçu en héros à Istanbul, en 1913. C’est mérité. L’année suivante, il écrit en vain aux dirigeants jeunes-turcs pour les dissuader de se ranger du côté de l’Allemagne en guerre (une folie, vu la fragilité de leur empire). Il a encore raison. Mais en 1917, il dérape. Craignant que les Arméniens de l’est du pays ne se rallient aux Russes qui envahissent cette région, le gouvernement turc a décidé de les déporter, et la plupart en mourront. Loti se trouve en France, il n’a qu’une connaissance très indirecte de la vérité. Néanmoins, il n’hésite pas à présenter le drame comme une tuerie réciproque. D’où une indignation arménienne pleinement justifiée.
On a calculé que, mises bout à bout, les escales turques de l’écrivain avaient occupé trois ans de sa vie. Or qu’a-t-il vu du pays, en dehors de Constantinople ? À l’ouest, brièvement, Brousse, ancienne capitale ottomane. Il n’a rien voulu savoir de l’est dur et sauvage.
Auprès de ce grand cycle d’Aziyadé, que certains lecteurs d’aujourd’hui jugeront sans doute exaspérant, mais qui n’est romanesque qu’en partie, et recèle des joyaux, le reste de la production romanesque fait assez pâle figure. Avec parfois, néanmoins, des pages captivantes.
Le Mariage de Loti, dédié à Sarah Bernhardt, est le second roman de l’auteur, et celui qui l’a lancé (1880). Toujours déguisé en officier britannique, il épouse à la mode tahitienne la jolie Rarahu, suivante de la reine Pomaré. Mais ce « mariage » ne pourra durer, Rarahu le sait bien. D’ailleurs elle tousse (et Loti ne manque pas de le noter, pour atténuer sa responsabilité). Il repart, nécessité de service. Elle se console un moment avec un officier français puis meurt. Loti ne revient pas, il a simplement une dernière vision de la pauvrette. Appréciation : une héroïne touchante mais peu consistante, un héros d’un égoïsme assez tranquille.
L’année suivante, Le Roman d’un spahi se déroule à Saint-Louis du Sénégal. Le spahi est grand et beau – exactement ce que Loti aurait aimé être. Il vit avec une mulâtresse très claire. Comme tous les livres de Loti, celui-ci est entrecoupé de mots autochtones, de digressions sur le folklore (ici, les griots) et de lettres authentiques que l’auteur a reçues d’Europe. Le spahi congédie la pauvre Fatou. Mais elle met au monde un enfant presque blanc. Le spahi lui donne alors tout ce qui lui reste d’argent et est tué en combattant une tribu indigène rebelle. J’avoue avoir eu quelque peine à m’intéresser à ce livre.
Mon frère Yves (1883) : encore un héros grand et fort ! Ce marin de commerce n’a qu’un défaut, sa tendance à la boisson, héritée de son ivrogne de père. En le prenant sous sa protection, Loti parvient à limiter quelque temps les dégâts. Yves se marie avec une payse, une Bretonne. Mais, son protecteur s’étant éloigné, il glisse à nouveau sur sa pente. Le livre reste sans conclusion. Certains lecteurs l’ont aimé. Je l’ai trouvé franchement médiocre.
Pêcheurs d’Islande (1886) est de loin le roman le plus réussi. Le lieutenant de vaisseau Viaud connaissait ces rudes travailleurs pour les avoir escortés avec un modeste navire de guerre, servant à la fois d’hôpital et de bureau de poste. L’héroïne est conventionnelle : la pieuse petite Paimpolaise qui attend le retour de l’homme parti au loin. L’originalité appartient au héros, encore un robuste gaillard, resté longtemps célibataire, et qui disait en riant : Je suis marié avec la mer. Or voici qu’il épouse la petite Bretonne. La mer jalouse engloutit son bateau.
Autre scène saisissante, dans le même livre : les marins de Paimpol voient arriver, dans les brumes, un bateau de pêche qu’ils connaissaient mais dont ils n’avaient plus de nouvelles. Ils échangent quelques propos avec l’équipage. Puis le nouveau venu se retire dans le brouillard. Les Paimpolais comprennent alors qu’ils ont eu affaire à un navire-fantôme, piloté par des morts.
Avec Madame Chrysanthème (1887), Loti revient au thème des noces pour rire. Par le canal d’un entremetteur, il a conclu un mariage fictif avec une jolie Japonaise. Gentille, mais ce n’est qu’une poupée. Un prétexte à présenter au lecteur divers bibelots, et un Japon mignard. Loti n’a pressenti ni la guerre russo-japonaise de 1904, ni la période 1937-1945. À la fin, Chrysanthème vérifie au moyen d’un petit marteau les piastres que son ex-époux lui a remises en exécution du contrat.
Heureusement, un librettiste italien et le grand Puccini transforment cette bluette cynique en un opéra émouvant, Madame Butterfly (1904). Devenu américain et rebaptisé Pinkerton, le « héros » étale la suffisance et l’incompréhension occidentales. La pauvre Japonaise meurt de chagrin, après avoir confié son enfant à l’épouse américaine de son ex-amant. C’est cela que Loti aurait dû écrire.
Dans Ramuntcho (1897), aimable roman basque avec trop d’adjectifs et une pincée de folklore, un jeune contrebandier s’éprend de Gracieuse. Mais il doit accomplir un service militaire de trois ans dans le nord de le France. Il ne revient qu’au terme de cette période (peu vraisemblable), et découvre que sous la pression de sa famille, Gracieuse est entrée au couvent. Le projet du jeune homme consiste à l’enlever et à partir avec elle pour les Amériques, en compagnie d’autres migrants basques. Confiante, la mère supérieure le laisse bavarder au parloir avec son ancienne fiancée. Mais en la voyant si tranquille, si bien ancrée dans sa nouvelle vie, Raymond n’ose se découvrir. Elle se retire pour chanter avec ses sœurs O crux ave, spes unica. Il ira en Amérique – sans elle. Ce n’est pas vraiment triste.
Plusieurs romans de Loti ont été portés à la scène. Car à cette époque dépourvue de cinéma et de télévision, le théâtre est roi. Mais ces œuvres essentiellement descriptives ne sont pas faites pour les planches. Aujourd’hui, il ne viendrait à l’esprit de personne de les rejouer.
xxx
Notre auteur est à son meilleur dans les récits de voyage – libérés du souci de mener une intrigue. Passons sur La Mort de Philae (1907), où il prend un peu trop la pose – allant jusqu’à se laisser enfermer de nuit dans l’enclos d’un temple pour mieux jouir du clair de lune. Laissons aussi son emphatique Jérusalem (1894), où il décrit la perte définitive de sa foi chrétienne en des lieux saints décevants, envahis par d’affreux touristes occidentaux. C’est une mise en scène. La perte était déjà consommée vingt-cinq ans plus tôt, à en juger d’après le portrait un peu outré qui nous est livré dans Aziyadé : Je ne crois à rien ni à personne ; je n’aime personne ni rien ; je n’ai ni foi ni espérance. Un seul monument de la ville sainte trouve grâce à ses yeux, la mosquée d’Omar, qui lui inspire ce commentaire : l’islam pourrait… devenir la forme religieuse extérieure, toute d’imagination et d’art, dans laquelle s’envelopperait mon incroyance.
Une expédition privée de 1899-1900 donne naissance à son livre L’Inde (sans les Anglais). Pourquoi cette parenthèse rageuse ? Parce que la Grande-Bretagne vient de faire une guerre inégale aux Boers, soulevant l’indignation d’une bonne partie de l’Europe. Faute de pouvoir chasser les Britanniques de cette Inde qu’ils pillent, Loti évite tout contact avec eux, et se contente de rencontres avec des autochtones. Le prétexte de son voyage est la remise des palmes académiques, de la part de l’Académie française, au maharadjah de Travancore, dans l’extrême sud de la péninsule.
Trop d’or, trop d’argent, trop de pierreries dans ce récit, même si la description de la sécheresse et de la famine fait diversion. Le brave dieu-éléphant Ganech, personnage favori du panthéon hindou, est qualifié de monstrueux et d’horrible. Les grottes d’Ellora, que j’ai appréciées de visu, sont dites épouvantables. La tigresse apprivoisée du maharadjah lorgne les enfants cadavériques.
Loti nous offre quand même de beaux passages, sur les canaux du Kerala, sur les ruines de Golconde, sur celles de Delhi, sur les cités radjpoutes. Je les préfère à son tableau de Bénarès, assez exagéré si j’en juge d’après ma propre visite une centaine d’années plus tard.
À vrai dire, Loti est surtout venu chercher une sagesse. Les débuts le déçoivent. Le bouddhisme, observé à Ceylan, me semble une chose finie, morte. Il forme un pendant à la décrépitude et la décadence de l’Inde brahmanique. Puis le voyageur s’engoue de Bénarès, qu’il place, contrairement à la vraisemblance géographique, à la fin de son volume. Mourir au bord du Gange, supplie-t-il, avoir là son cadavre baigné une suprême fois, avoir là sa cendre jetée ! Et il ajoute : Le germe nouveau qui a été déposé dans mon âme est destiné à l’envahir. Où finit la sincérité, où commence la pose ? Loti ne reviendra point en ces lieux. Pour lui, la vraie tentation, jamais tout à fait victorieuse, reste celle de l’islam.
Son chef d’œuvre, à mon goût (et je ne suis pas le seul), c’est Vers Ispahan – relation d’un voyage de cinquante jours effectué en 1900. L’auteur est en congé sans solde. Au lieu de revenir des Indes par la voie maritime et le canal de Suez, comme tous les autres voyageurs, il entreprend de passer par la Perse. Et l’on voit là que son personnage d’écrivain maniéré, voire déliquescent, cachait un dur-à-cuire. Malgré ses cinquante ans, il n’hésite pas à s’infliger trois semaines de chevauchée sur des pistes dangereuses, en faisant étape dans des caravansérails pleins d’immondices.
L’aventure commence sur la rive étouffante du Golfe qu’on appelle persique. Comme le chemin de fer n’existe pas encore, on doit escalader à cheval ou mulet le triple rempart du plateau iranien – de nuit, à cause de la chaleur. L’écrivain a constitué sa propre caravane, de huit ou neuf personnes. Les sabots des montures glissent sur la pierraille, la chute dans les précipices est évitée de justesse. Pour protéger les voyageurs des brigands, chacun des villages traversés doit fournir une escorte de deux ou trois cavaliers, mais on ne peut vraiment compter dessus. D’où l’enthousiasme de Loti à son arrivée à Chiraz, la ville des poètes, ancienne capitale de la Perse, et encore magnifique, malgré la vétusté. On oublie tout ce qu’il a fallu endurer pendant le voyage, les grimpades nocturnes, les veilles, la poussière et la vermine ; on est payé de tout.
Loti parle assez bien le turc, que beaucoup de notables persans comprennent. Cela lui permet des contacts directs, dont d’autres voyageurs occidentaux n’ont pu bénéficier.
Après Chiraz, la petite expédition chemine sur le haut plateau frisquet mais fleuri – notamment de pavots blancs dont sera extrait l’opium pour l’Extrême-Orient. Ispahan, autre ancienne capitale du pays, se révèle encore plus beau que Chiraz. Malheureusement, la population est xénophobe et elle a quelque raison de l’être, car la Grande-Bretagne et la Russie sont en train de se partager la Perse en deux zones d’influence. L’arrivée de Loti provoque une émeute ; il doit se réfugier chez le seul consul européen de la ville, celui de la Russie. Mais il n’en garde point rancune, comme le montre le titre de son livre.
La suite du parcours est l’occasion de décrire les scènes de lamentation et de flagellation qui marquent l’anniversaire de la mort de l’imam Hussein. Familier de l’islam sounnite, Loti s’avoue déconcerté par l’islam chiite.
Il ne s’intéresse guère à Téhéran, capitale récente, trop moderne. Mais il est reçu par les plus hauts personnages : le prince héritier, le frère du chah, le grand vizir… Et tous ces interlocuteurs de haut rang parlent français. En cette région du monde, le prestige de notre culture se trouve encore à son zénith. L’écrivain est conscient de la fragilité de ce privilège.
Reste à franchir la cordillère qui sépare Téhéran de la Caspienne. Cette fois, les obstacles ne sont plus la pierraille et les déserts, mais la boue et les crues de rivières provoquées par des pluies diluviennes. Loti doit payer de sa propre bourse une réparation de fortune sur un pont. Arrivé enfin sur le rivage, il s’embarque sur un vapeur à destination de Bakou. De là, le trajet sur les voies ferrées russes puis sur celles d’Europe centrale n’est plus qu’un jeu d’enfant, par comparaison avec ce qui a précédé.
Cinquante jours de frissons et d’enchantements. Quand le lecteur parvient à la dernière page de Vers Ispahan, il se dit que ce n’est pas la peine de visiter l’Iran d’aujourd’hui, et qu’il y serait déçu à tout coup. Mieux vaut rester en 1900, sous le charme de Loti.
À peine le capitaine de frégate Viaud est-il rentré chez lui que la Marine nationale l’expédie en Chine. Il s’agit d’y protéger les résidents français des Boxeurs révoltés contre les influences étrangères et excités par l’impératrice T’seu H’si. Mais le temps que le navire arrive, les troupes japonaises et russes ont fait le ménage avec brutalité.
Ami des Turcs et des Arabes, Loti n’éprouve pas de sympathie particulière pour les Chinois. Il les comprend mal. Il rappelle que les Boxeurs ont tué et violé à tort et à travers, et détruit la légation de France (nous dirions aujourd’hui l’ambassade) après deux mois de siège. Mais il rend hommage à la plus ancienne des civilisations survivantes. Il mentionne sans indulgence les vols et les déprédations commis par les soldats étrangers. Sept pays se sont ligués contre la Chine : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, États-Unis, Russie, Japon. Leur nombre et leur diversité expliquent qu’en fin de compte, la Chine ne soit jamais devenue la colonie de l’un d’eux.
Cette fois, il n’y a vraiment pas matière à des descriptions voluptueuses. La campagne est grise, les habitants fuient, les eaux sont polluées. Les soldats français transportent de l’eau bouillie dans d’affreuses bouteilles, avec pour bouchons des pommes de terre crues qu’ils ont taillées. Partout des cadavres, gisants ou flottants – et des rôdeurs les ont scalpés, afin de confectionner des perruques.
La capitale a quand même conservé son animation, son commerce, son décor. Ville de découpures et de dorures, ville où tout est griffu et cornu. Alors pourquoi ce titre, Les derniers jours de Pékin, pour le livre qui rassemble ses articles parus dans le Figaro ? Loti a senti venir la fin de la métropole impériale. La révolution éclatera en 1911, par contrecoup de l’humiliation subie onze ans plus tôt du temps des Boxeurs. Le Pékin d’aujourd’hui est bien plus peuplé qu’à l’époque. Il s’enorgueillit de trois autoroutes périphériques et concentriques. Mais il ne rappelle que de loin celui qu’a vu notre observateur.
Celui-ci s’offre le plaisir puéril de coucher dans le palais de l’impératrice. Il y fume l’opium. Il prélève deux petits souliers rouges dont il se persuade qu’ils ont appartenu à T’seu Hsi. Après quelques visites aux prêtres français, dont les catéchumènes ont beaucoup souffert, et bien sûr aux tombeaux impériaux, il fait ses adieux à cet empire démesuré, où pensent et spéculent quatre ou cinq cents millions de cerveaux tournés au rebours des nôtres et que nous ne déchiffrerons jamais.
Mais cet incorrigible collectionneur emporte avec lui dix caisses de bibelots et autres souvenirs, dont il sait très bien que les vendeurs étaient des pillards.
xxx
Ce butin est destiné à sa fabuleuse maison de Rochefort, où il entasse ses trésors. Les métaphores fusent. Caverne d’Ali Baba ! Marché aux puces ! Palais du facteur Cheval ! Hélas, c’est fermé pour travaux depuis 2012, sans annonce de réouverture.
Un jour, à Constantinople, Loti s’entretenait avec l’un de ses zélateurs, Gabriel de La Rochefoucauld. Il émettait des doutes sur la vie future. Puis, soudain : Il est pourtant inadmissible que des âmes comme la mienne ne survivent pas. Qu’il se rassure, où qu’il soit. L’inadmissible ne se produira point.
Les livres
Les romans de Loti ont été réunis dans un volume de la collection Omnibus (2011).
Ses récits de voyage sont rassemblés dans un volume de la collection Bouquins (rééd. 2018).
L’exposé de la mystification se trouve dans Marc Hélys, Le Secret des Désenchantées, 1923, rééd. Manucius 2004. L’Istanbul d’Orhan Pamuk, avec nombreuses petites photos de diverses provenances dont l’auteur lui-même, est disponible en Folio.